« Des jours de marche. Ils n’en voyaient pas le bout. Ils respiraient le brouillard. Ils perdaient la cadence. Ils étaient saouls de forêt. Ils n’avançaient pas. Comme énergie, il ne restait pas lourd. Crispés du bloc des mâchoires jusqu’au dernier orteil, ils étaient là d’aplomb à peu près. Les paupières râpeuses, prises de drôles de battements, le cou moite, le corps entier d’une raideur ! Ils tenaient. Stupides le jour, fiévreux la nuit, ils tenaient.
Les nerfs. »
A l’origine, des dessins à la mine de plomb trouvés dans l’atelier de Denis Pouppeville et une nouvelle guerre patriotique, écho d’une autre presque centenaire. Nicole Caligaris se saisit des dessins, « change de plan », modifie le cadre, transpose autre chose. Elle écrit un livre épuré, ciselé, aux phrases simples, courtes, directes, séparées par des temps de pause, brèves respirations dans un texte que l’on dévore en apnée. Le livre paraît, sans les dessins, au Mercure de France en 1996. Les dessins passent entre les mains des amateurs, éparpillés. Vingt ans plus tard, la boucle se referme, Denis Pouppeville s’inspire du roman et dessine de nouveau, à l’encre noire cette fois, pour une réédition au Nouvel Attila. L’éditeur, depuis ses débuts, hybride textes, images et typographie : « On a pris le parti qu’aucune photo ou aucun dessin ne soit purement illustratif, c’est plutôt des liens sous-jacents. » (1) La Scie patriotique est irréprochable. Dès la première page, le lecteur est happé et sait que le livre ne va pas le lâcher, que les mots vont rester. Le silence. Le blanc. Le blanc foulé au pied qui devient boue. L’humanité qui devient boue. La boue qui colle les vêtements aux corps, colmate les pensées, cimente entre elles la bêtise et l’absurdité.
A l’arrière-garde du front, dans les sous-sols d’une banlieue en lisière de forêt, la Ultième C incarne tout l’absurde et le grotesque de la guerre. Celle-ci pourrait se dérouler dans les tranchées de Verdun ou dans les bourbiers bosniaques. N’importe quelle guerre. Bête, patriote, sale comme toutes. La Ultième s’y est ensevelie. Au-dessus d’elle, les immeubles détruits, éventrés, les gravats. Elle n’arrive jamais que dans des villes déjà dévastées par l’avant des troupes, désertées, vidées de leur population, et entraperçoit au loin les camions qui emportent les restes. Elle est chargée des charniers, des tombes dans la terre gelée, des bûchers enflammés à l’essence. Elle a fouillé les décombres et fait chou blanc. Tout est dévasté, rien ne reste ni ne subsiste. Elle a chassé les survivants, les laissés-pour-compte, les fuyards à la traîne, elle a fait danser des vieillards à la pointe du canon dans une église.
Quand les hommes ont vu une poule, ils n’ont pas su la tuer. (Pas de mort propre. Tout est sale et stupide.) Sur tout, ils s’acharnent, écrasent, écrabouillent. Ils ont cherché de quoi se nourrir, mais il n’y a plus rien nulle part, alors ils se sont terrés. « Ici on était seuls, enfermés dans les caves. » (Plusieurs fois, dans le livre, répété : « Ici on était seuls, enfermés dans les caves. ») La Ultième ne connaît pas le confort du sommeil. Pour manger, elle gratte la mousse des sous-sols où elle se cache, bouillie infâme. Parfois un rat. Parfois, pire. L’odeur nauséabonde de la viande que les hommes ont du mal à avaler. Ils connaissent sa provenance. La Ultième veut aller au combat — débusquer, tuer, piller : « la pourriture », « les rats », « les cancrelats » conspués par le chant patriotique oublié par les hommes abandonnés aux corps délabrés. Sûr que « la pourriture », « les rats », « les cancrelats » se gavent, s’en mettent plein la panse des victuailles emportées à bord des camions ou cachées dans leurs planques. Mais, pour l’arrière-garde, pas d’ordres d’en haut, de l’avant, de nulle part. Dès le départ, quelque chose de définitif. L’imparfait renforce la sensation d’un temps gélatineux, comme si la fin était déjà advenue et le début imprécis.

Pour commencer, Noël, jour de trêve, la neige, l’écœurant brouet et du schnaps, par caisses. Ebriété générale : le capitaine se saisit d’une scie et tranche. Une gorge, le mât du drapeau. Alors, la Ultième s’ébranle, mouvement que rien n’arrête, vers le front, se battre enfin, pourquoi on ne sait pas, avancer, bêtement, sans savoir où, se perdre, jusqu’à l’épuisement, jusqu’à la folie. La troupe avance, l’ennemi se dérobe sans fin. Egarement, dans la forêt menaçante où la troupe glacée trouve une poupée vivante, joujou à manipuler, à casser, à plier, à tordre, à faire valser, tournoyer. Bête humaine, chiffe molle blanche et rouge. « C’était une fille. Ça se touchait. » Les hommes sont, au fil des pages, de plus en plus hagards. Violents. Dispersés. Englués. « Ils ». « Certains ». « On ». « Les hommes ». Masse imprécise, d’où seulement trois émergent — Septime Sévère, Rigodon, Hilaire. Le capitaine à la scie égoïne qui coupe tout ce qui dépasse, le chefaillon dégueulasse qui fait danser les autres, le rigolo du lot. Frère livide, à la fin de la troupe, le « Der des Ders », n’a pas de nom. La Joujou non plus.
La guerre broie les individualités. Lessive, rince, essore. Puis recouvre d’une croûte crasseuse les esprits et les corps malades, pleins de furoncles, traversés d’« une terrible toux qui montait de très loin et déchirait son chemin de façon pas bien propre. » Corps trop présents, exposés, étalés là, indistincts, qui surgissent du papier, emplissent de pleines pages, gueules déformées, lippes pendantes, yeux renfoncés, air bête de décérébrés qui suivent les ordres — « Ils étaient un seul corps à eux tous. Abattus, abêtis. Un corps fiévreux, toujours pénible, toujours tremblant. » Traits noirs, forts, visages et corps appuyés, grotesques, qui tranchent avec la perfection immaculée du livre et de sa jaquette translucide, avec le rectiligne des marges, cadres blêmes comme la neige qui entourent le texte. Sur tout ce blanc, le sang-de-bœuf des titres de chapitre recèle déjà de la cruauté, le noir du texte saute aux yeux, à la gorge, on ne peut pas en réchapper.
« La Ultième C Les hommes étaient arrêtés à l’entrée du sous-sol, le battant de métal au-dessus de leur tête, relevé à fond. Ils regardaient dehors. Tout était sous la neige.
Ce silence.
Ils restaient là, bousculés, soufflés, sans voix, ramassés les uns contre les autres, au bord de l’ombre. Suspendus. Dehors. La blancheur du ciel et la blancheur du sol. Eux qui venaient de passer des semaines à la lueur gris chiche des trous d’aération, ils regardaient cette perfection comme un mirage. La tête leur tournait. Ils avaient l’obscurité dans le dos ; là-devant ils croyaient voir un gouffre, la terre manquer : blanc. Ça tanguait au possible cette clarté, cette neige. Ils grelottaient, hébétés à la lisière du jour ouvert. Ils n’osaient pas y entrer.
Derrière eux la nuit était lourde. Elle sentait l’homme, le moisi, le cheveu malpropre, la fausse chaleur des affaires sales tout le temps humides, des gouttières salivant le long des murs nuit et jour sans différence, des choses fourgonnées, des pompes qui raclent, des pieds qui traînent, des toux. C’était plus que permis, ce silence. La densité n’existait plus. L’air était vif, claquant comme du linge, blanc étourdissant. La neige ne portait pas une trace. Ça ressemblait tant au sommeil impeccable qu’ils espéraient le soir, ce blanc tiré sur tout. Un tel sommeil ne venait pour personne. »
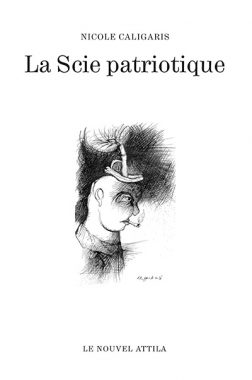 La Scie patriotique, Nicole Caligaris.
La Scie patriotique, Nicole Caligaris.
Avec douze dessins de Denis Pouppeville.
Le Nouvel Attila, 2016. 122 pages.
Maquette de Dominique Bordes.
(1) Les multiples vies de Benoît Virot (1) _ d’une revue à l’édition — DIACRITIK
 Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire
Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire


Merci, Lou, pour cette lecture tonique, à la fois en harmonie et en perspective, c’est un plaisir.
À propos de la guerre, de la Grande Guerre, connaissez-vous ce roman extraordinaire que je viens de découvrir grâce aux éd. Belles Lettres : La Vie dans la tombe, de Stràtis Myrivìlis, traduit du grec par Louis-Carle Bonnard et André Protopazzi ?
Nicole Caligaris
Bonjour Nicole, merci pour ce mot ! Je ne connaissais pas La vie dans la tombe, le travail de la langue a l’air aussi intéressant que le sujet, merci pour le conseil. Lou.