C’est d’un livre très particulier dont je vais vous parler aujourd’hui; un livre aux allures d’herbier syntaxique, un récit brut et rocailleux, qui nous plonge au coeur de la Haute-Provence rurale, déconnectée et sauvage.
Nous voilà sur les pas de Farigoule Bastard, berger revêche vivant dans un minuscule village que l’appel de la ville dépeuple et tue petit-à-petit. Invité à Paris à un vernissage dont il est soit-disant l’auteur, il entreprend un long périple à dos de mule et de chemin de fer, traversant ces monts et vaux provinciaux à la fois arides et fourmillants, les poches emplies de thym et de galets, la tête pleine de souvenirs et de remords qui ressurgissent en vrac.
Ces tribulations internes forment un récit d’un nouveau genre, tout à fait prenant et envoûtant, où tout s’entrechoque et roule, où le patois forme une mélodie piquante aux effluves ensoleillées pour nous raconter le quotidien de gens hors du temps. Des gens à la vie bien rude mais qui, justement, ont su préserver un regard franc et attentif à toute cette nature capricieuse qui les entoure et qui prend racines en eux.
«Toute cette lande devenue pins. Toute cette terre arable devenue lande. Le paysage est à rebours. Toute cette marche est une bombe, qui va exploser. Tous ces moutons disparus. Tous ces loups et ces vautours qui reviennent, mais personne pour les accueillir. Ce pays se meurt et j’attends. J’attends le prochain éléphant.»
Alternant plusieurs narrateurs, voguant entre Farigoule Bastard, les deux mystérieuses femmes qu’il a aimées et son ami Picris, ce texte prend aux tripes par sa franchise et sa mélancolie, retient chaque parcelle de notre attention par sa syntaxe si particulière: parfois liste poétique à la répétition langoureuse, parfois pensée pure vomie telle quelle, ou bien encore prose soignée et touchante: autant de facettes qui font de ce livre une petite pépite. Beaucoup de passages méritent d’être retranscrits, tous même.
«Elle présage d’un sentiment très simple pourtant, comme un rocher ou un sapotier pour un chemin, chez nous on l’appelle mémoire ou amour, pour les mules et autres bêtes proches, ce sentiment porte le nom plus simple de la mort.»
C’est beau, touchant, et triste aussi. Car ce petit roman tout mince renferme au coeur de ses quelques 120 pages tout un pan de pays qui tombe dans l’oubli, avec ses habitants chérissants leurs traditions. Ils sont un peu comme les derniers arbres d’une très vieille forêt pleine de mystères, qui a connu une heure de gloire pétaradante et qui dépéri lentement mais surement. Ce sont de vieilles souches tendres qui racontent leurs vies solitaires et cassantes.
Un des plus beaux livres que j’ai eu l’occasion de tenir entre mes mains. C’est tout simplement ça.
Le Nouvel Attila
123 pages
Caroline
 Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire
Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire
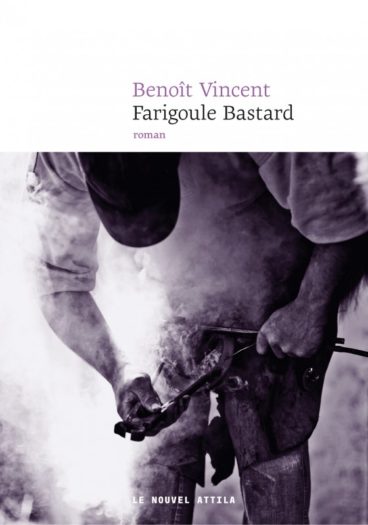


2 Commentaires
Pingback: Féroce, de Benoît Vincent. Aux éditions Bakélite.
Pingback: Ouvrir la valise. - Un dernier livre avant la fin du monde