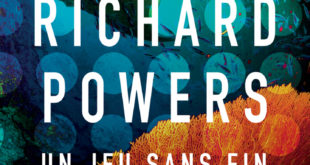« Peut-être que c’est l’évènement qui m’a inventé […]. Alors que j’écrivais Libra, il m’est apparu que de nombreuses orientations dans mes huit premiers romans semblaient se rassembler autour de ce centre obscur qu’est l’assassinat. Je ne serais peut-être pas devenu l’écrivain que je suis si cet assassinat n’avait pas eu lieu. »
Don Delillo, « An Outsider in this society », interview réalisée par Anthony De Curtis.
C’était écrit, depuis des années, l’auteur nous préparait, consciemment ou non, à l’arrivée de cet événement. Dès Americana, ou encore dans Les joueurs, nous pouvions sentir l’ombre des fantômes d’Oswald et de Kennedy habiter l’univers de Don Delillo. Un événement historique qui aurait pu être inventé par l’auteur, tant la trame et l’imaginaire autour de cet assassinat porte en son sein ce qui fait de l’auteur un écrivain aussi singulier et passionnant.
Bien loin de l’éternel questionnement sur ce qui s’est réellement passé. Delillo s’empare du sujet et questionne par le biais de Lee Harvey Oswald le parcours d’une nation dans sa narration et ses luttes intestines pour asseoir sa suprématie.
Car Libra, c’est l’histoire du tueur, Lee Oswald, le “Harvey” viendra plus tard, par besoin de fiction de la presse, en réponse au « Fitzgerald » de JFK, son parcours sur les dix années qui vont le mener à l’assassinat du président à Dallas. Un parcours commençant dans les tunnels du métro new-yorkais, jusqu’à Dallas. Entre la découverte du communisme, de Trotski, l’armée américaine et notamment une base de U2 (avion espion de la CIA) comme officier radar, au Japon, puis un passage en URSS, notamment à Minsk, où il rencontrera sa femme, pour finir par un retour en Amérique.
En parallèle, nous suivons les sept mois qui ont mené à l’organisation d’un complot visant à construire une fausse tentative de meurtre. Celle du président. Afin de faire croire à un complot cubain et justifier le retour des USA à Cuba après le cuisant échec de la baie des cochons.
Enfin, il y a Nicholas Branch, un agent de la CIA chargé par l’agence de compiler tous les documents afin de raconter l’histoire secrète des événements des années après.
Comment la narration construit le mythe. Tel pourrait être le propos de Libra. Don Delillo développe ici la narration d’ Oswald, celle que le personnage s’invente, venant rencontrer celle d’anciens agents de la CIA désireux de prendre une revanche sur Cuba. Une somme monstre de lieux, de personnages, d’événements, constituant un tout tentaculaire ayant pour zone de convergence Dallas, le 22 novembre 1963. Et c’est ce besoin de narration pour justifier les actes comme dynamique d’ensemble, qui ressort du roman.
Ce que le personnage de Nicholas Branch appuie lors de ses quelques passages. Il faut une histoire, secrète ou publique. Qu’importe le réel. Ceci est avant tout une fiction au service d’un résultat. Nous rencontrons aussi d’autres narrations, discordantes, notamment le témoignage de Marguerite, la mère de Lee Oswald, venant interroger quant à la figure public qu’était son fils, par rapport à ce qu’elle se racontait de ce dernier.
Ce tout, ce marasme de paroles, de lieux, de temps, forment un tout, comme un témoignage ultime d’un pays et d’une époque, en plein égarement et se cherchant au travers de ses échecs, de ses névroses et de son identité. Comme un besoin d’équilibre, d’une balance venant équilibrer les différents éléments et permettre ainsi d’harmoniser le réel et la fiction pour n’en faire jaillir qu’une chose, l’Histoire américaine.
Tout en tranchant radicalement avec son esthétisme subtil et plus feutré, ou encore ses incartades totalement méta, l’auteur ici se veut plus frontal, plus dans une forme d’urgence narrative. Comme dans une frénésie de mots pour nous faire ressentir le côté viscéral de cette histoire. Nous pouvions déjà le ressentir avec Running Dog, il y avait cette notion de quasi-fuite en avant. Ici, au travers du personnage de Lee Oswald, nous ne sommes que fuite en avant. Car le personnage à l’image de cette sublime scène d’ouverture, n’est que tourné vers la suite, assez prétentieusement d’ailleurs, vers l’avenir, au point de régulièrement se saborder durant son parcours. C’était comme s’il avait cherché sa vie durant une forme de vérité qui se trouvait devant lui, dans un avenir secret, seulement accessible par lui-même.
“Il y a un monde à l’intérieur du monde.
Il prit le métro jusqu’à Inwood, puis jusqu’à Sheepshead Bay. Il y avait des hommes à l’air sérieux, là-bas, se balançant dans des rocking-chairs, dans une lumière cuivrée. Il vit des Chinois, des mendiants des hommes qui parlaient à Dieu, des hommes qui vivaient dans des wagons, jour et nuit, couverts de bleus, les cheveux en broussaille, voués à la longue patience, endormis, sur des sièges en bois. Un jour, il sortit du compartiment. Il resta là entre deux voitures, s’agrippant à d’énormes chaînes. Il sentait le frottement des roues dans ses dents. Ça allait si vite parfois ! Il aimait cette impression d’être à la limite de quelque chose. Comment pouvait-on être sûr que le conducteur n’était pas fou ? Cette idée lui donnait une curieuse excitation. Les roues faisaient jaillir des milliers d’étincelles d’un bleu éblouissant, dans un bruit terrible, à la limite de la folie. Les gens s’entassaient, chaque visage s’inscrivant dans le livre général des visages. Ils se bousculaient pour franchis les portes, puis se tenaient aux poignées de porcelaine. Il était là pour le plaisir. Le bruit avait un pouvoir, une force presque humaine. L’obscurité aussi avait un pouvoir. C’était quelque chose de secret et de puissant. Ces lignes révélaient des choses secrètes. Le brui était accordé à une fureur qui se trouvait quelque part dans le cerveau, un déferlement de fureur et de douleur, extrêmement satisfaisant.
Jamais plus dans sa courte vie, jamais plus dans ce monde, il ne parviendrait à éprouver cette puissance intérieure montant comme un cri, cette force secrète de l’âme qu’il allait chercher dans les tunnels creusés sous New York.”
In fine, nous pourrons noter que dans Libra, Don Delillo, n’oublie pas ses incursions introspectives qui permettent, aux lecteurs, de ressentir pleinement les enjeux et les constructions idéologiques et superstitieuses de Lee Oswald et d’autres personnages.
Libra est un livre monstre. Un roman monumental, une fiction dantesque, qui s’intéresse, par le biais d’un événement, au parcours d’une nation en pleine mutation, ayant pour principal motivation ses névroses. Il s’agit là, du livre le plus abordable de l’auteur, mais aussi, très certainement un de ses meilleurs romans.
C’est le livre de référence de James Ellroy, qui lui inspirera sa trilogie Underworld USA, c’est un livre de essentiel pour bon nombre d’auteurs, comme Stephen King par exemple. Bien que l’exercice soit toujours périlleux, celui de proposer une relecture de l’histoire, tout comme Joyce Carol Oates a pu le faire avec brio avec son Blonde, Don Delillo réussi l’exercice magistralement et propose un livre passionnant et profondément viscéral.
 Actes Sud,
Actes Sud,
Babel,
Trad. Michel Courtois-Fourcy,
650 pages,
Ted.
 Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire
Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire