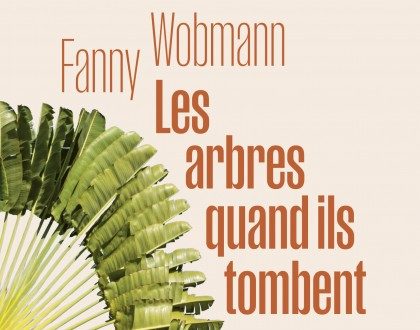Remonter le fil des réminiscences ambiguës, en réunir les miettes d’enfance. Reconstruire l’autrefois à partir de photographies soigneusement couchées entre les pages d’un album. Retisser grâce aux paroles échangées avec celles et ceux qui était là et à avec sa propre mémoire. C’est ce travail qu’entreprend Fanny Wobmann avec Les Arbres quand ils tombent : celui de la lenteur complexe des impressions où ses souvenirs malgaches s’entrelacent avec une réalité autrement plus vive.
Engagé par la DDC, son père se voit proposer une mission humanitaire de plusieurs années à Madagascar. Sa femme et ses deux filles l’y rejoignent, et c’est ainsi que l’autrice passe une partie de sa jeunesse dans ce pays où rien ne ressemble à sa Suisse natale. Dans leur maison coloniale, il et elles jouissent d’un confort de vie en tout point supérieur à celui des Malgaches qui, s’il lui semblait naturel lorsqu’elle était petite, soulève une dorénavant foule de questions et même un certain malaise dans son esprit d’adulte.
Mais comment parler du privilège Blanc, des acquis sociaux dont bénéficiaient ses parents (et par ruissellement, elle-même) de par leur statut d’expatriés, sans blesser ou commettre de maladresse ? Comment capturer les vibrations d’un monde en perpétuel mouvement tout en se débarrassant des lianes étouffantes qui nous collent la peau, parvenir à déconstruire et pardonner ? Et surtout, que soulève la chute des arbres, l’abattage des branches qui, jusqu’ici, obscurcissaient la mémoire ?
“Ma compagnie de théâtre a obtenu une bourse de recherche pour développer un projet. Ma collègue et moi nous y consacrons à plein temps pendant un mois. Je me lance avec difficulté dans ce nouvel univers, dans ces nouvelles réflexions. Il faut changer de rythme, de forme artistique, de méthode. J’ai peur de perdre le lien avec mon texte si j’arrête d’écrire, de couper l’élan qui me guide depuis plusieurs semaines, alors je continue, dans les moments de pause, les trajets en train. Les thématiques se mélangent dans mon esprit, se nourrissent mutuellement, le potentiel de création me semble infini.
Je m’installe dans le café vide du théâtre et j’écoute. Les vocalises d’une comédienne qui s’échauffe, la ventilation, la bouilloire, une exclamation quelque part, les grincements d’une chaise dans le hall, le silence étouffé de la scène plongée dans le noir.
Peut-être que ce que je voudrais comprendre, c’est ce que j’essaie de dire, au fond, depuis tout ce temps. Depuis les poèmes dans mon journal intime, depuis les spectacles dans mon jardin malgache. Pourquoi je considère avoir une légitimité à le dire.“
En observant l’empreinte laissée par sa vie malgache, Fanny Wobmann interroge par petite touche sa place et celle de sa famille dans ce quotidien marqué par la domination blanche. Les Arbres quand ils tombent est entrecoupé de la correspondance épistolaire qu’elle entretient avec Nirina, son amie d’enfance malgache (deux continents et des années de séparation sont réunis quelques secondes, par mail). De citations empruntées, entre autres, à Annie Ernaux et Françoise Vergés. Les poèmes d’Audre Lorde entrent en résonance avec de la podcastrice Claire Richard… Mais des voix plus proches s’y expriment également, celles de la mère et de la sœur de l’auteure, blessées par la lecture du manuscrit. Les souvenirs se bousculent alors, les arrêtes des points de vue capturés entrent en fiction.
D’une écriture engagée et vibrante, Fanny Wobmann ose lever le voile sur le tabou du colonialisme suisse. En partant de la masse brumeuse de son enfance dont seules quelques scènes chauffées à blanc se découpent avec netteté, elle démêle patiemment le fantasme de la réalité. Consciente de l’inconstance de sa mémoire peu aidée par des photos vidées de leur substance à force d’avoir été trop regardées, elle se tourne vers les autres. Elle se documente, recueille des souvenirs pour reconstruire le puzzle d’un vécu intime étroitement lié avec l’Histoire, qu’elle soit conjuguée au passé, au présent comme au futur.
“J’imprime et relis l’ensemble de mon texte. Je réécris plusieurs passages, j’en coupe certains. Il manque des scènes malgaches, les souvenirs sont trop peu nombreux. Je prends mon carnet, mon porte-mine et je creuse ma mémoire, je note les images, les sons, les odeurs qui me reviennent, sans me censurer, sans les rejeter parce que je n’en ai pas une vision précise ou parce que ce ne sont que des bribes, des morceaux sans lien les uns avec les autres. Je découvre que les souvenirs en amènent d’autres.
J’ai ouvert une nouvelle porte et je suis étonnée de la profondeur de la brèche qu’elle dévoile.
Alors j’écris des paysages, des baignades, notre maison, la ville, et je triche, j’insère ces passages dans les parties rédigées au printemps dernier, en été, en automne. J’accentue, ponctue, relève. Tisse les liens. Ajoute des feuilles aux arbres ou des taches de neige sur les sommets.
C’est rassurant et exaltant, quoi qu’il arrive désormais, je peux prendre hier et le mettre à la place d’il y a dix ans, je peux prendre demain et en brouiller les contours dans l’eau trouble d’une rivière malgache.“
Les Arbres quand ils tombent forme donc un pont de réflexion entre plusieurs temporalités, allant des montagnes suisses à l’océan malgache. Partout, on constate le très fort rattachement émotif et sensoriel que porte l’autrice à son environnement : paroles, odeurs, poussière, soleil… L’eau y est omniprésente, que ce soit sous la forme de vagues joueuses, du calme d’un lac, du silence de la neige comme des gouttes de sueur perlant sur la peau.
Le Rwanda, Madagascar, le Jura se superposent ainsi, tandis que Fanny Wombann creuse son rapport à l’autre et à soi, sa relation avec sa sœur, sa mère, son amie Nirina. Elle soulève la problématique d’un racisme ancré et banalisé au point de tomber dans une indifférence normalisée. Elle bouscule, développe, interroge sa légitimité à raconter en empruntant des pistes de cours et d’esprit qui emportent un peu de sel en eux.
“La nuit en hiver est différente. Insondable, envahissante, porteuse de petits fantômes. Ils ricanent ou se contentent de s’installer là. Ils pèsent un peu. Peut-être parce que les gens s’efforcent de continuer à vivre dans cette nuit, comme si elle n’existait pas, ils parlent, marchent, travaillent, prennent le train, mangent, boivent, rient, pleurent, courent, rentrent à la maison, vont chercher leurs enfants, les tiennent par la main, vont au fitness, à la piscine, au yoga. Mais regardent dans les maisons illuminées comment vivent les autres, écrasent les feuilles mortes éclairées par les lampadaires, ne voient pas la lune à cause des lampadaires, portent le poids des petits fantômes. Et font comme s’ils n’existaient pas.“
 Quidam éditeur
Quidam éditeur
202 pages
Caroline
 Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire
Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire