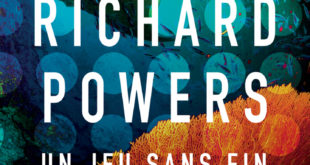Retenez ce numéro, le 37. La trente septième publication de la collection « Une heure lumière » risque de faire parler d’elle. Un titre qui risque de pas mal diviser, mais aussi, et surtout, un texte qui est beaucoup plus fin et malin qu’il n’y paraît. Bienvenue dans la « Ville-rue » de Paul Di Filippo.
Paul Di Filippo est un auteur, visiblement, peu connu en hexagone, alors qu’il est l’auteur d’une quinzaine de romans, et d’un bon paquet de nouvelles, nous n’avons pu le voir en librairie que pour « Langues étrangères » chez Robert Laffont en 2002, ainsi que dans un numéro de Bifrost. Cet auteur de Rhode Island au États-Unis est pourtant très actif dans le milieu de la science-fiction outre atlantique. En dehors de sa fiction, ce dernier participe activement au milieu en étant critique littéraire pour Asimov’s Science Fiction, The Magazine of Fantasy and Science Fiction, Science Fiction Eye, The New York Review of Science Fiction, Interzone, et Nova Express (excusez du peu.), et s’est même acoquiné avec le milieu comics en ayant écrit le scénario de “Beyond the Farthest Precinct” publié chez America’s Best Comics. Nous avons à faire à un ogre littéraire, autant créateur d’œuvres qu’avide lecteur, et ayant la réputation d’avoir une connaissance encyclopédique.
« Un an dans la ville-rue » prend place dans une immense ville, un ruban urbain, s’étendant jusqu’à… Personne ne le sait, bordé par un chemin de fer d’un côté et un fleuve de l’autre. l’histoire raconte la vie de Diego Patchen, fils du mourant patriarche Gaddis Patchen et qui est en couple avec une pompière . Ce dernier est auteur de récits spéculatifs, en opposition à un format de récit s’ancrant dans le réel, comme des documentaires-fictions. Il est l’auteur d’œuvres questionnant le réel, et cherchant des alternatives à leur monde, à la « Ville-Rue ». Le récit spéculatif, est plus méprisé par l’intelligentsia, mais rencontre un succès fou auprès des classes populaires. Ce dernier s’apprête à sortir son ton premier recueil de nouvelles, ce qui va l’emmener à fréquenter la haute société et se retrouver invité à une croisière ayant pour but d’explorer les blocs de la ville inconnus par les habitants du quartier Vilgravier.
Au-delà du récit de voyage du protagoniste, ce qui interroge énormément tout le long de la lecture, c’est la sensation de percevoir un sous texte dans l’histoire. Le monde est intrigant, ce principe de ville-rue, est fascinant ( est-ce un tore, un ruban de moebius?), tout en se permettant d’être une critique de notre société avec ces principes de classes, les addictions aux drogues, notamment, le mépris de classe, un élitisme artistique, politique et philosophique. Mais le tout étant distillé dans une surabondance de détails, de noms, d’informations, comme si l’auteur souhaitant avant tout nous égarer, pour mieux nous atteindre.
On peut, dans la première partie trouver une filiation évidente avec les romans-feuilletons de Charles Dickens, tant sur le travail d’ambiance, que de réflexion sur la société, les classes laborieuses et ce côté ascenseur social pré-existant et dépendant d’un riche homme d’affaires, souhaitant mettre en avant son protégé (dans un premier temps l’éditeur). Puis vient très vite une seconde filiation, plus contemporaine, plus spéculative, mais non encore Science-fictionnesque, le post-modernisme.
Si l’on s’en réfère au analyses des philosophes Lyotard, Derrida et Beaudrillard, le postmodernisme est en rupture avec le modernisme, s’articulant sur trois points, elle prend sa source dans le petit récit, se joue de la narration et des lecteurs, et enfin se propose comme étant un simulacre du réel. Je fais cours pour ne pas perdre le fil, mais en gros, le postmodernisme s’inscrit dans un mouvement littéraire empruntant et déformant les codes de la Littérature, tout en proposant des possibles discordant avec le réel ( voir les théories des complots qui parcours l’oeuvre de certains auteurs comme Thomas Pynchon), tout en étant richement référencé par la culture populaire, la culture des classes moyennes, de la culture opposée à celle de la haute société. Dans la construction, exit la figure du héro, et la quête initiatique ou de sens, le roman post moderne veut s’autoriser tout les possibles, usant même parfois de la métafiction pour saper le travail de l’auteur de manière ludique ou absurde.
Tout ça pour en venir au fait, que doucement s’impose cette évidence dans la lecture du roman et Paul Di Filippo, de manière ludique, nous l’affiche par certains noms totalement farfelue dans la droite lignée de Thomas Pynchon, voir même nomme certains personnages nommés en référence à des auteurs de ce mouvement Gaddis Patchen pour William Gaddis, on croise un Evenson pour Brian Evenson, Etc… Un jeu de pistes qui se construit aussi sur le long, de part le parcours du protagoniste, ou l’évolution narrative, se mutant subtilement du roman feuilleton dickensien, devenant récit de voyage, puis en roman social osant même emprunter quelques code au Dirty Realism.
Un an dans la ville-rue est un récit sur les romans populaires, sur leurs formes et évolutions, et quoi de plus spéculatifs et plus grandioses que de l’inscrire dans un roman alternatif de type science-fiction voir steampunk, genre populaire très largement sous-évalué par les milieux littéraires dit classiques.
Pour revenir au sujet du roman, il faut lire « Un an dans la ville-rue », lire même peut-être deux fois ce court récit pour apprécier l’histoire, superbe du début à la fin, comme pour comprendre le texte sous-jacent proposé par l’auteur. Car il s’agit là bel et bien d’une réussite tout autant sur le fond que sur la forme, et qui propose une œuvre aussi courte que dense et surtout passionnante.
Paul Di Filippo est un pari osé pour les éditions du Bélial’, alors espérons de tout cœur que ce titre va rencontrer le succès qu’il mérite, et que d’autres textes de l’auteur viendront, et si possible toujours traduit par l’excellent Pierre-Paul Durastanti.
 Le Bélial’,
Le Bélial’,
Une heure lumière,
Trad. Pierre-Paul Durastanti,
120 pages,
Ted.
 Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire
Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire