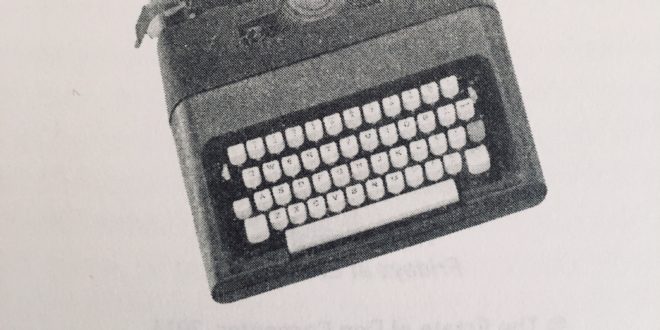Traductrice d’auteurs appelés à figurer longtemps dans le panthéon de la littérature américaine (entre autres Laura Kasischke dont le roman Eden Springs est paru récemment aux éditions Page à Page), de grands oubliés (Don Carpenter chez Cambourakis) ou d’essayistes féministes (en tête Rebecca Solnit, chez L’Olivier), Céline Leroy nous parle avec passion et esprit de son métier et des auteurs qui l’entourent (ou la hantent – malgré, avoue-t-elle, de piètres dons médiumniques. Comment lui en vouloir ?).
Traductrice d’auteurs appelés à figurer longtemps dans le panthéon de la littérature américaine (entre autres Laura Kasischke dont le roman Eden Springs est paru récemment aux éditions Page à Page), de grands oubliés (Don Carpenter chez Cambourakis) ou d’essayistes féministes (en tête Rebecca Solnit, chez L’Olivier), Céline Leroy nous parle avec passion et esprit de son métier et des auteurs qui l’entourent (ou la hantent – malgré, avoue-t-elle, de piètres dons médiumniques. Comment lui en vouloir ?).
Comment marche exactement le monde de la traduction ? Le point de départ est-il l’éditeur qui sollicite des traducteurs, ou inversement un traducteur qui s’entiche d’un auteur et qu’il propose à différents éditeurs ?
Aujourd’hui oui, ce sont plutôt les éditeurs (ou responsables des traductions puisque ce poste existe dans quelques maisons comme chez Belfond ou dans le groupe Libella, par exemple) qui font appel aux traducteurs, parce qu’ils ont déjà travaillé avec eux, qu’une confiance a été établie. Quand les éditrices connaissent bien leurs traductrices (je mets tout au féminin puisque ces métiers sont désormais largement féminins), elles choisissent les projets en fonction des personnes, de leurs goûts, de leur(s) domaine(s) de prédilection. Ce n’est pas le cas partout, mais cela arrive. C’est du moins mon expérience. Quant à apporter des projets, cela se fait, bien qu’assez rarement, même si les petites maisons travaillent souvent en lien étroit avec des traducteurs et comptent sur eux pour apporter des projets. Dans les grandes maisons, c’est plus compliqué car les éditrices sont en contact avec les agents et éditeurs étrangers et reçoivent les textes très en amont. Mais pour ce qui est de mon cas personnel, j’ai par exemple apporté Renata Adler aux éditions de L’Olivier. J’étais tombée sur ses deux romans suite à la lecture d’un article sur un blog et je savais que le ton, la forme, l’histoire même de l’autrice intéresseraient l’éditrice, Nathalie Zberro, avec qui je travaillais déjà (et avec qui je continue de travailler maintenant qu’elle dirige le domaine étranger de Rivages). J’ai quelques autres livres sous le coude, mais ce travail prend du temps.
Quels sont vos critères pour choisir vos traductions, vous dont l’éclectisme va de la traduction de roman, de poésie et même d’essais ?
Les premières années, le critère était surtout financier… On me proposait du travail, j’en avais besoin, et je ne me voyais pas le refuser parce que je trouvais le texte un peu bancal. Mais j’ai eu une chance assez inouïe car on m’a tout de suite proposé des textes intéressants. Qu’on se rassure toutefois, j’ai aussi eu mon lot de romans décevants, de dialogues et de scènes de sexe ridicules, de narrations émaillées d’incohérences et de personnages têtes à claques dont il a fallu supporter la compagnie pendant quelques mois. Maintenant que j’ai plus d’expérience et que je peux m’offrir le luxe de choisir, je vais vers les textes qui me font vibrer, qu’il s’agisse de primo-romanciers ou d’auteurs déjà publiés ou oubliés. Quand les éditions Page à page m’ont contactée pour traduire un recueil de poésie de Laura Kasischke, je me suis une fois de plus sentie très chanceuse et il n’était pas question de dire non. En plus, c’était l’occasion de retrouver une autrice que j’aime autant comme personne que comme artiste. Pour ce qui est des essais, il s’agit peut-être d’un désir d’engagement plus vaste, plus politique. Rebecca Solnit est l’une des intellectuelles les plus influentes des Etats-Unis, ses champs d’observation sont vastes, mais couvrent des domaines qui m’intéressent, du féminisme à l’environnement, en passant par la littérature et une réflexion poussée sur le langage. Il me paraissait capital qu’elle puisse de nouveau être accessible au lectorat francophone (Actes Sud avait commencé à la publier au début des années 2000 et ce sont désormais les éditions de L’Olivier qui ont repris le flambeau), je voulais faire partie de cette aventure, me mettre au service de quelque chose d’important et qui me tenait à cœur. J’espère bien pouvoir continuer à explorer ces différents genres que sont la poésie et la non-fiction.
D’ailleurs, est-ce plus facile de traduire un essai comme celui de Rebecca Solnit plutôt qu’un roman ? (sans parler de la traduction de poésie, reconnue comme étant l’exercice le plus difficile pour un traducteur)
Je ne sais pas si c’est plus difficile. Disons que c’est différent. Et puis ça dépend des traductrices et traducteurs. Pour moi, la non-fiction n’est pas du tout une évidence. La construction des phrases n’est pas la même, le rythme qui leur est imprimé non plus, il y a beaucoup plus de tournures passives, par exemple. Et même si Rebecca Solnit possède un indéniable talent littéraire, les messages et les analyses qu’elle veut faire passer doivent primer sur le reste. Je crois aussi que c’est une question d’habitude. Je travaille actuellement à un autre livre de Rebecca Solnit, ça me paraît un peu moins dur, et manifestement, ça n’est pas parce que l’auteur a simplifié ses écrits. Cependant, j’ai l’impression que le travail sur le style qu’exige la traduction de fiction m’est plus naturel. Une histoire d’oreille et de musicalité, je crois. Quant à la poésie… Pour ma part, il m’a semblé devoir réapprendre entièrement mon métier. L’ardoise magique avait tout effacé et en plus, on m’avait changé les manettes. C’est effrayant et parfaitement grisant ! Mais là encore, je crois que c’est une question de sensibilité. Un ami gallois traducteur de l’espagnol ne s’occupe que de poésie. Il s’y reconnaît plus. Il trouve que la fiction exige un engagement de longue haleine qu’il ne serait peut-être pas capable de tenir.
Quel rapport doit entretenir le traducteur avec l’auteur du texte original ? Une trop grande proximité nuirait-elle à la traduction, ou au contraire permettrait-elle une meilleure approche du texte ? (je crois que Josée Kamoun disait qu’elle avait besoin d’être au contact de Philip Roth pour mieux appréhender ses romans et les traduire).
Il n’y a pas de règle et les gens doivent faire comme ils le sentent, à mon avis. Pour les auteurs morts, la question est vite réglée car je ne sais pas encore faire tourner les tables. Je le regrette, d’ailleurs, parce que j’aurais adoré parler à Don Carpenter et Leonard Michaels (à qui j’en ai beaucoup voulu d’être mort à peine une poignée d’années avant que je ne le traduise; les auteurs sont rageants, des fois). Il y a des auteurs que je n’ai pas eu l’occasion de rencontrer et à qui je n’ai pas eu de questions à poser. Mais ça ne veut pas dire que je ne voudrais pas les connaître. Pour ceux avec qui je suis en contact, il n’est pas faux de dire que ça me donne de petits indices sur leur travail. Je reconnais dans l’écriture de Peter Heller, certaines expressions qu’il emploie à l’oral, je reconnais des expériences personnelles et des histoires familiales dans les parcours de certains de ces personnages et ça rend la compréhension plus immédiate. Il m’a aussi été très utile de connaître Laura Kasichke au moment de traduire sa poésie. Du fait de la pauvreté de mon expérience en la matière, je me posais des tas de questions, dont certaines que je trouvais idiotes, mais sachant qu’elle serait bienveillante et puisque nous nous connaissions depuis un certain temps, je n’ai pas hésité à les poser. Connaître Renata Adler m’a aussi énormément aidée car j’ai découvert que sa façon intrigante de construire son récit était tout bonnement la façon dont elle construisait son rapport au monde. C’était donc très éclairant et encore plus fascinant. Quand les auteurs sont généreux, c’est un vrai plaisir dont on aurait bien tort de se priver.
Il m’a aussi été très utile de connaître Laura Kasichke au moment de traduire sa poésie. Du fait de la pauvreté de mon expérience en la matière, je me posais des tas de questions, dont certaines que je trouvais idiotes, mais sachant qu’elle serait bienveillante et puisque nous nous connaissions depuis un certain temps, je n’ai pas hésité à les poser. Connaître Renata Adler m’a aussi énormément aidée car j’ai découvert que sa façon intrigante de construire son récit était tout bonnement la façon dont elle construisait son rapport au monde. C’était donc très éclairant et encore plus fascinant. Quand les auteurs sont généreux, c’est un vrai plaisir dont on aurait bien tort de se priver.
Est-il plus facile de traduire des écrivains contemporains ? (par rapport à la langue notamment, ou aux sujets abordés ?)
Pour moi, oui. Mais c’est aussi parce que tout dans mon parcours, m’a portée vers la littérature contemporaine. C’est la littérature que j’ai étudiée, celle que je connais le mieux. Et même si je lis et apprécie énormément les littératures plus anciennes, je serais bien en peine de les traduire. Je manque de tout, vocabulaire, contexte historique, socio-économique et culturel… Ça me demanderait un temps infini que je n’ai malheureusement pas.
Que pensez-vous des retraductions ? Une traduction s’inscrit-elle davantage dans son époque que le texte original ? (je pense notamment aux polars américains des années 30 massacrés par les traductions de l’époque, que l’on redécouvre aujourd’hui, ou bien des romans d’Erskine Caldwell traduits par Maurice Edgar Coindreau avec un argot daté – bien qu’hilarant)
Petite précision avant toute chose : Maurice Edgar Coindreau est un dieu de la traduction, n’ayons pas peur des mots. Ce qu’il a fait avec Faulkner, Goyen et tant d’autres est exceptionnel et si j’arrive un jour ne serait-ce qu’à sa cheville, ça sera une formidable réussite, alors pas question pour moi de lui reprocher quoi que ce soit. Certaines de ses traductions n’ont pas pris une ride et c’est un exploit. Maintenant, il est normal que certains aspects des traductions vieillissent. Le monde change, le vocabulaire pour le décrire aussi. Une traduction est donc marquée par son temps. Cela se voit particulièrement avec les vocables de l’oralité. Ce n’est pas pour ça qu’une trad est mauvaise. La question des polars est un peu part. La Série Noire avait une charte, un ton et une longueur à respecter, d’où le “massacre”. Mais ça a tout de même donné quelques petites choses savoureuses. Des titres comme Fantasia chez les ploucs ou La reine des pommes méritent d’exister, même s’il est aussi salutaire de repasser derrière pour donner à lire ce qui se trouve réellement dans le texte original. Mais donc, oui, mille fois oui pour les retraductions ! Des fois pour les dépoussiérer, d’autres pour découvrir des aspects nouveaux du texte.
Plus spécifiquement sur votre travail : parlez-nous de Don Carpenter. Comment l’avez-vous découvert ? Quelle a été la genèse de vos traductions ? Est-ce Cambourakis qui vous a sollicité ?
Dans leurs premières années d’existence, les éditions Cambourakis avaient un petit comité de lecture (qui était aussi l’occasion de discuter du programme de publication et de se faire un bonne bouffe entre amis). Julien De la Panneterie, lecteur à l’œil de lynx et libraire hors pair était très impliqué dans le travail éditorial. Un soir, il est arrivé avec une pile de bouquins, dont celui-ci. J’ai récupéré le tout et Carpenter est vraiment sorti du lot, pour ne pas dire qu’il m’a sauté à la gorge. Les autres ont lu, sont tombés d’accord et j’ai proposé de le traduire.
 Qu’est-ce qui vous a plus dans son œuvre ?
Qu’est-ce qui vous a plus dans son œuvre ?
Ce qui m’a frappée d’emblée en dehors même de la noirceur, c’est l’empathie sans bornes de l’auteur pour ses personnages, son insistance à toujours aller chercher leur part d’humanité, d’où qu’ils viennent et quoi qu’ils fassent. Ce qui est très intrigant et original chez Carpenter, aussi, c’est la construction de ses livres. Il a la manie de laisser la fin en suspens, par exemple, ou de faire surgir (ou disparaître) des personnages très importants en cours de route. C’est étonnant, personne ne se permettrait trop ça, aujourd’hui, mais lui le fait et ça marche. Parce que ces personnages existent totalement dans l’esprit du lecteur. Je crois qu’on va pouvoir le constater une fois de plus avec le titre qui sortira en janvier prochain (Clair obscur – Blade of light – deuxième roman de Don, bien noir et bien dense).
Laura Kasischke a d’abord été connue en France par le biais d’une autre traductrice. Comment l’avez-vous “récupérée” ?
En fait, Laura a eu plusieurs traducteurs et traductrices. Anne Wicke est la toute première et a traduit les quatre premiers parus chez Bourgois, j’ai pris la suite pour deux titres, puis est venu Eric Chédaille pour deux titres également et enfin Aurélie Tronchet pour le dernier titre publié chez Bourgois. J’ai repris le flambeau pour les livres parus aux éditions Page à page. A moi pour toujours (Be mine) et Rêves de garçons (Boy heaven) ont été publiés à peu de temps d’écart aux Etats-Unis et les éditions Bourgois voulaient les sortir ensemble. Anne Wicke n’ayant pas le temps de prendre en charge les deux textes, on m’a confié le plus court.
Est-ce pénalisant pour un auteur d’avoir plusieurs traducteurs ? Ou au contraire, chaque traducteur apporte-t-il sa sensibilité ou sa voix ?
Je n’ai pas fait d’étude comparée de traductions d’un même auteur par plusieurs personnes et je ne sais pas si c’est préjudiciable. Mais il est clair que chaque traducteur aborde un texte avec sa sensibilité, son histoire, son expérience et que cela peut modifier la réception qu’on a d’un auteur. Cependant, je ne pense pas que cela ait beaucoup d’incidence quand les différents traducteurs sont bons.
Comment travaillez-vous avec les éditions Page à Page ? La Laura Kasischke parue chez cet éditeur semble s’éloigner un peu de celle des éditions Bourgois : poésie, nouvelles, roman poétique fragmentaire (Eden Springs). Est-ce une volonté éditoriale ?
 La collaboration avec Page à page est amicale, détendue & respectueuse. Tout ce dont peut rêver une traductrice, il faut bien le dire. Si c’est une volonté éditoriale, c’est un peu par défaut. J’ignore ce qui a poussé les éditions Bourgois à ne pas publier la poésie, les nouvelles ou ce roman fragmentaire, mais du coup, le beau travail de Page à page vient compléter celui de Bourgois pour donner une image encore plus précise de l’œuvre de Laura en montrant la diversité de ses formes d’écriture.
La collaboration avec Page à page est amicale, détendue & respectueuse. Tout ce dont peut rêver une traductrice, il faut bien le dire. Si c’est une volonté éditoriale, c’est un peu par défaut. J’ignore ce qui a poussé les éditions Bourgois à ne pas publier la poésie, les nouvelles ou ce roman fragmentaire, mais du coup, le beau travail de Page à page vient compléter celui de Bourgois pour donner une image encore plus précise de l’œuvre de Laura en montrant la diversité de ses formes d’écriture.
Existe-il un fil conducteur entre tous les auteurs que vous traduisez ? Y a t-il un lien caché entre Don Carpenter, Laura Kasischke, Peter Heller, Matthew Weiner ?
Pas que je sache. Je traduis beaucoup de femmes parce qu’il est très important pour moi de faire entendre leur voix si souvent étouffée ou pire, peut-être, un peu méprisée. Vous savez, ce clivage usé jusqu’à la corde des livres de bonne femme versus les livres de ces messieurs qui toucheraient forcément toujours à l’universel. Heureusement, la réalité est plus complexe, mais pour s’en rendre compte et pour faire évoluer les clichés qui nous empêchent d’avancer, il faut que toutes les voix soient représentées (celles de femmes, des minorités etc.). Les auteurs et autrices qui me tiennent le plus à cœur travaillent avec passion autant la forme que le fond, chacun(e) à leur manière. C’est peut-être ça, le fil conducteur. Dans ces livres, j’ai aussi pas mal de gens à côté de la plaque, des doux perdus, des violents perdus, des marginalisés (par choix ou parce que la société l’a décidé pour eux), des mélancoliques ascendants désespérés, des bravaches, des rêveurs, des amoureux, d’autres avec des super pouvoirs encombrants, bref, tout ce qui fait le terreau d’une bonne littérature, je crois (j’espère).
De quelle traduction êtes-vous la plus fière ?
Oh, la question piège, la question impossible! Je suis très fière des deux Renata Adler, par exemple, parce que c’est une autrice que j’ai apportée et qu’elle était particulièrement difficile à traduire.  Je suis très fière des trois Leonard Micheals parce que je n’en reviens toujours pas d’avoir mené à bien ces projets tant ils étaient complexes (surtout l’anthologie de nouvelles – Conteurs, menteurs paru chez Bourgois – qui représente quarante ans de production) et parce que cet auteur m’a renversée dès la première phrase lue. En fait, je suis fière de toutes mes traductions dans le sens où j’assume d’avoir traduit ces textes, les bons comme les moins bons. Ils m’ont chacun apporté ou appris quelque chose. Et puis tout texte venu de l’étranger qui paraît en français, c’est un enrichissement culturel, linguistique, et qui n’a pas besoin de cet enrichissement là ? Vous me pardonnerez cette jolie tarte à la crème, mais ça n’en reste pas moins vrai.
Je suis très fière des trois Leonard Micheals parce que je n’en reviens toujours pas d’avoir mené à bien ces projets tant ils étaient complexes (surtout l’anthologie de nouvelles – Conteurs, menteurs paru chez Bourgois – qui représente quarante ans de production) et parce que cet auteur m’a renversée dès la première phrase lue. En fait, je suis fière de toutes mes traductions dans le sens où j’assume d’avoir traduit ces textes, les bons comme les moins bons. Ils m’ont chacun apporté ou appris quelque chose. Et puis tout texte venu de l’étranger qui paraît en français, c’est un enrichissement culturel, linguistique, et qui n’a pas besoin de cet enrichissement là ? Vous me pardonnerez cette jolie tarte à la crème, mais ça n’en reste pas moins vrai.
Qu’est-ce qu’une bonne traduction ?
Cette question à elle seule pourrait faire l’objet d’une thèse. Il y a d’ailleurs sûrement même plusieurs thèses sur le sujet. Je vais donc répondre par ce qui est pour moi une énorme évidence. Une bonne traduction est une traduction qui respecte l’esprit du texte plus que la lettre. Je ne parlerai pas de la fluidité de la traduction, ou de sa transparence, qui peuvent être des leurres. Des traductions peuvent être fluides et passer à côté de l’original, le banaliser, le déformer. J’en reste donc à l’esprit. Et c’est un programme déjà bien chargé, croyez-moi, un but pas facile à atteindre. Et après, pour se faire du bien, on peut renverser les choses et se rappeler ce que disait Borges : l’original est infidèle à la traduction. Et si l’auteur se mettait un peu au diapason du traducteur, tiens ! Pierre Bayard, si vous nous entendez… (je signale dès à présent aux éditions de Minuit que je prends 1% comme apporteuse de projet.)
 Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire
Un dernier livre avant la fin du monde WebZine Littéraire